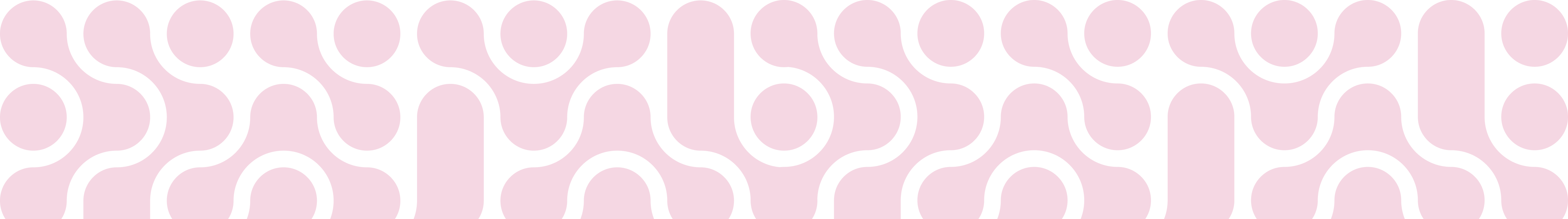Réunion Annuelle d'AMMnet 2023

Allocution d'ouverture
La réunion a débuté avec Jennifer Gardy de la Fondation Bill & Melinda Gates qui a discuté de l'importance de la modélisation dans l'écosystème du paludisme. Le Dr Gardy a parlé de l'importance de comprendre les risques et de déployer des interventions anciennes et nouvelles. Elle est fière de cette communauté, unique en son genre car elle place le leadership africain au cœur de la lutte pour l'éradication du paludisme.
Jennifer Gardy a été suivie par Jaline Gerardin qui a parlé de l'histoire d'AMMNet. En 18 mois, l'AMMNet compte plus de 850 membres, 8 AMMNet régionaux, 68 pays, 20 webinaires, 16 bulletins d'information, 4 bourses de voyage, 11 membres du conseil d'administration, 2 groupes linguistiques et a financé 13 événements locaux. L'histoire d'AMMNet sera mise en lumière lors de la revue de fin d'année de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle.
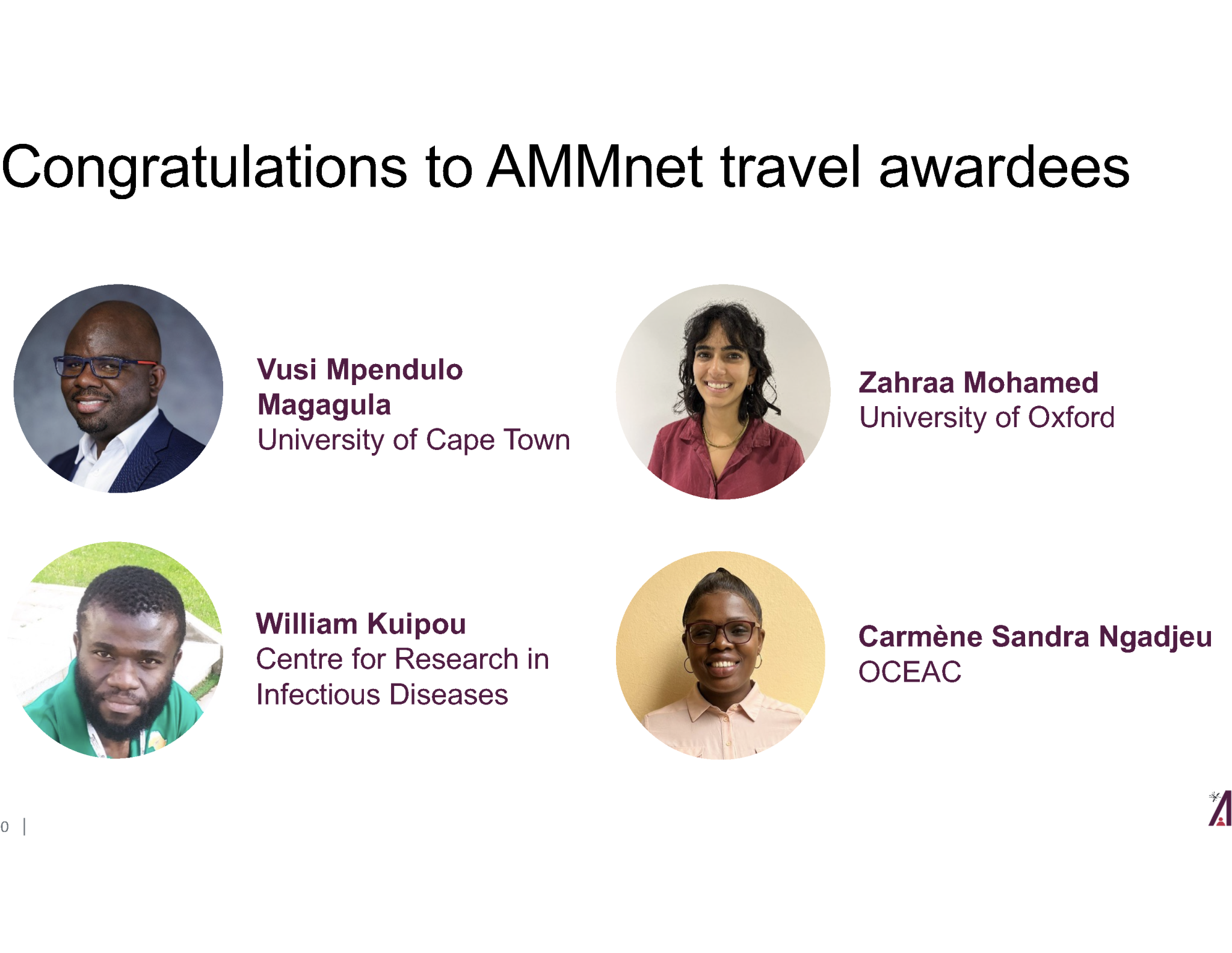
Cette année, 10 présentations étaient à la fois en personne et virtuelles, une session d'affiches, une table ronde et des discussions en petits groupes.
Session 1 : Contextes nationaux
Animé par Akindeh Nji, Université de Yaoundé, Cameroun
Jeanne Lémant
Pays: Suisse
Établissement : Institut tropical et de santé publique suisse
Thème : Modélisation à l'appui des décisions concernant les extensions géographiques et démographiques de la chimioprévention du paludisme saisonnier au Bénin.
Pays : GhanaAbstract
La chimioprévention du paludisme saisonnier (SMC) est mise en œuvre au Bénin depuis 2019 et a ciblé plus de 400 000 enfants de moins de 5 ans dans les départements septentrionaux d'Alibori et d'Atacora en 2021. Le Programme national de lutte contre le paludisme (NMCP) du Bénin a récemment envisagé une extension du SMC, soit sur le plan démographique (les enfants âgés de 5 à 10 ans des mêmes départements bénéficieraient également du SMC), soit sur le plan géographique pour les enfants de moins de 5 ans des nouveaux départements éligibles selon les critères de l'OMS. Aucune de ces extensions n'ayant été testée auparavant, le NMCP s'est tourné vers la modélisation pour estimer leur impact. Le modèle OpenMalaria a été calibré pour représenter l'historique des interventions antipaludiques et le risque de transmission au Bénin, ainsi que la structure par âge de la population. Les futures interventions déjà prévues (campagnes de distribution massive de moustiquaires, SMC chez les enfants de moins de 5 ans à Alibori et Atacora, projets pilotes de traitement préventif intermittent chez les nourrissons) ont été simulées, ainsi que les deux extensions du SMC. Le modèle prévoyait que l'extension démographique du SMC pourrait éviter en moyenne 4,6 cas graves pour 1 000 enfants ciblés entre 2024 et 2026, tandis que l'extension géographique pourrait éviter en moyenne entre 13 et 14,3 cas graves pour 1 000 enfants de moins de 5 ans, selon le département. Pour être moins rentable que l'extension démographique, l'extension géographique devrait donc être trois fois plus coûteuse, alors que les coûts de la campagne 2021 indiquent qu'elle ne coûterait que 40 % de plus. Le nombre de cas graves évités par enfant ciblé était similaire entre les zones opérationnelles des départements considérés pour l'extension géographique, probablement en raison de risques de transmission similaires. Ces résultats ont conduit à recommander de cibler en priorité les zones très peuplées, car le SMC dans les trois zones les plus peuplées pourrait éviter autant de cas graves que dans les six autres zones. La modélisation a permis non seulement de choisir l'extension géographique plutôt que l'extension démographique, mais également de quantifier leur impact comparatif. La modélisation peut être utilisée pour répondre aux questions des décideurs lorsqu'ils sont étroitement associés au processus, qu'il s'agisse de l'affinement de la question de modélisation ou du choix des indicateurs épidémiologiques.
Remarques:
Au cours de sa présentation, Jeanne a donné un aperçu de la SMC au Bénin. En 2019, le Bénin a lancé le SMC dans deux zones du nord pour les enfants de 3 à 59 mois chaque mois entre juillet et octobre. Après que l'OMS a modifié la recommandation pour les enfants de moins de 10 ans, la question s'est posée de savoir s'il fallait étendre le programme sur le plan démographique pour inclure les enfants de moins de 10 ans dans les 2 zones ou étendre géographiquement le SMC au reste du pays tout en maintenant le seuil des 5 ans.
Le groupe de Jeanne a utilisé le modèle OpenMalaria, qui comprend un modèle basé sur des agents pour les humains et un modèle pour les moustiques avec une interaction entre les deux. Les données locales ont été utilisées pour adapter le modèle au contexte béninois et deux interventions, les moustiquaires et le SMC, ont été incluses. Le modèle prévoyait au moins 4 fois plus de cas évités et 3,4 fois plus de cas évités pour 1 000 USD pour l'extension géographique par rapport à l'extension démographique. Cela reflète l'impact communautaire car il inclut des cas de tous âges.
Les limites incluaient une couverture SMC constante à 80 %, des coûts constants et une efficacité basée sur des essais cliniques, qui peuvent être surestimés (mais étaient identiques pour les deux stratégies) et une saisonnalité constante.
Pendant les questions, Jeanne a parlé de sa collaboration avec le NMCP d'où provenait la question initiale. Le groupe a produit un tableau de bord pour le NMCP afin qu'il puisse choisir des indicateurs pertinents pour lui.
Moussa Kane
Pays : Sénégal
Établissement : WAMCAD (Développement des capacités de modélisation mathématique en Afrique de l'Ouest) et MARCAD (Consortium pour le développement des capacités de recherche sur le paludisme)
Thème : Modélisation mathématique de la dynamique de transmission du paludisme dans les zones à faible transmission : application à Keur Soce, Sénégal
Résumé
Le Sénégal connaît une baisse considérable du nombre de cas de paludisme. La zone de très faible transmission se situe dans le nord du pays et s'étend vers l'ouest et le centre. Cependant, le nombre de cas peut augmenter soudainement à tout moment, et parfois de manière incontrôlable. Cet article étudie comment éviter la résurgence de l'épidémie de paludisme dans des zones de pré-élimination telles que Keur Socé en développant un modèle mathématique de transmission du paludisme, construit en considérant un modèle SIRS-SI dans lequel des humains en bonne santé sont infectés par le parasite lorsqu'ils sont piqués par des moustiques infectieux tandis que les moustiques sains sont eux-mêmes infectés lorsqu'ils sont piqués par des humains infectieux. De plus, l'immunité des humains guéris est temporaire. Nous avons estimé le nombre de reproduction R_0 et discuté de la stabilité des équilibres exempts de maladie et endémiques. Des simulations numériques ont été réalisées à l'aide du logiciel Scilab pour confirmer nos résultats analytiques. Nous avons tiré des conclusions en analysant chaque paramètre de l'expression R_0. Mais d'abord, des moyennes mobiles centrées sont utilisées pour lisser les données sur la morbidité chronique due au paludisme de Keur Socé, afin de comprendre le passé, d'analyser et d'expliquer les valeurs observées et de prévoir l'avenir proche.
Remarques:
Moussa a présenté son analyse descriptive de l'incidence, y compris la saisonnalité, et a expliqué l'utilisation de modèles comportementaux pour faire des prévisions. Un modèle compartimental avec une composante humaine et une composante moustique a été utilisé. La formulation et l'analyse mathématique du modèle compartimental ont été expliquées, notamment à l'aide de matrices jacobiennes pour les équilibres endémiques et exempts de maladie.
Samuel Oppong
Pays : Ghana
Établissement : Programme national d'élimination du paludisme
Thème : Stratification de la charge de morbidité et adaptation infranationale des interventions pour le Ghana — comparaison de différentes méthodes d'ajustement pour l'incidence du paludisme.
Résumé
Dans le cadre des piliers de l'HBHI, à savoir l'utilisation d'informations stratégiques pour la prise de décisions, la stratification de la charge de morbidité au niveau infranational est impérative pour éclairer les interventions appropriées à déployer. En 2022, le nom du Programme national de lutte contre le paludisme du Ghana est passé de « Programme de lutte contre le paludisme » à « Programme d'élimination ». Cela a nécessité l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour refléter la portée et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'élimination. Ce résumé décrit les processus et les méthodes utilisés pour ajuster l'incidence brute des établissements de santé déclarée dans le système d'information sanitaire de routine. Les estimations brutes de l'incidence sont ajustées en fonction des taux de dépistage (niveau 1), des taux de déclaration (niveau 2) et du comportement en matière de soins de santé (niveau 3) afin de garantir la représentativité de l'incidence du paludisme dans le pays. Une analyse comparative de trois (3) méthodes d'ajustement différentes pour l'incidence de niveau 3 a été réalisée afin de déterminer celle qui fournissait des estimations les plus prudentes du taux d'incidence. Les trois méthodes étaient la méthode de l'OMS pour l'ajustement en fonction des comportements de recherche de santé, les estimations d'ajustement MAP et une adaptation spécifique au pays de la méthode d'ajustement de l'OMS pour les comportements de recherche de santé. Alors que la méthode d'ajustement de l'OMS pour le niveau 3 a surestimé les estimations moyennes du niveau 2 de trois fois, les estimations MAP ont montré très peu de variation entre les niveaux 2 et 3. La méthode d'ajustement au niveau 3 adoptée par le pays a multiplié par deux l'incidence moyenne de niveau 2, mais a été considérée comme prudente compte tenu d'autres développements qui ont eu un impact sur le paysage de la surveillance du paludisme dans le pays. Le troisième niveau d'incidence ajusté au niveau du district a été combiné aux estimations de prévalence du projet d'atlas du paludisme (MAP) et aux estimations de mortalité toutes causes confondues de l'Institute for Health Metrics and Evaluation afin de classer les districts en strates épidémiologiques très faibles, faibles, modérées et élevées.
Remarques:
Samuel a fourni des informations sur le paysage du paludisme au Ghana, notamment les récentes réductions de l'incidence du paludisme et les améliorations apportées aux tests (38 % à 98 %). SO a expliqué que les fichiers de formes contenant des données au niveau des pays concernent des régions et des districts différents par rapport à la version précédente. Il a parlé de l'adaptation aux comportements liés à la recherche de soins de santé qui conduisait à une multiplication par trois de l'incidence brute, ce qui pourrait être lié à la recherche de soins de santé dans le secteur public.
Les questions portaient notamment sur les plans futurs visant à comparer l'incidence chez les enfants de moins de 5 ans par rapport à celle des enfants de plus de 5 ans, ce qui fera partie de la thèse de doctorat de Samuel. Une autre question portait sur la fièvre causée par le virus du Nil occidental, mais Samuel a indiqué que cela n'avait pas joué un rôle important dans ce travail.
Moureen Ochieng
Pays : Ouganda
Établissement : Unité de modélisation épidémiologique des maladies infectieuses de l'université de Makerere (Idemu-MAK)
Thème : Modélisation de la grippe A.
Remarques:
Moureen a présenté un modèle SEIR compartimental pour la grippe A à l'aide d'un ensemble d'équations différentielles. Cela comprenait un compartiment sensible, exposé, infecté et deux compartiments guéris (un avec immunité et un sans immunité). Elle a décrit chacun des taux entre les compartiments et a expliqué les paramètres du modèle.
Séance 2 : Comprendre les risques et l'efficacité des interventions
Animé par Misonge Kapnang Ivan, Université de Dschang, Cameroun
Toussaint Rouamba
Pays : Burkina Faso
Établissement : Unité de recherche clinique de Nanoro
Thème : Modélisation des effets des conditions météorologiques sur la tendance temporelle du paludisme dans une petite zone, Burkina Faso
Résumé
Depuis des décennies, le changement climatique et ses effets sur les maladies font l'objet d'une attention croissante dans le monde entier. Cet effet peut être hétérogène, en particulier dans les régions où les cultures de contre-saison sont prédominantes, et il est essentiel d'évaluer l'effet de ces changements sur l'intensité de maladies telles que le paludisme. Cette étude explore les fluctuations à court terme des cas de paludisme et des variables météorologiques dans le district sanitaire de Nanoro, au Burkina Faso.
Les données sur les précipitations, l'humidité, la température et le paludisme pour la période 2010-2022 ont été analysées. Le test de Mann-Kendall a été utilisé pour évaluer la tendance de la série chronologique. Une analyse des points de variation a été réalisée pour détecter des changements significatifs dans la moyenne et la variance de la série pendant 676 semaines. La fonction de corrélation croisée (CCF) a été utilisée pour évaluer la relation statistique entre les variables météorologiques hebdomadaires (composantes principales) et l'incidence hebdomadaire du paludisme.
L'analyse détaillée des données sur 13 ans indique que les températures annuelles maximales et minimales annuelles n'ont pas montré de tendance à la hausse, tandis que l'incidence du paludisme a montré une tendance à la hausse. Trois périodes d'incidence du paludisme ont été constatées et réparties uniformément chaque année. Les précipitations et la température étaient associées de manière positive et significative à l'incidence du paludisme, avec un décalage de 9 et 14 semaines, respectivement.
Une meilleure compréhension de l'influence du climat sur le paludisme au niveau local permettrait de développer des campagnes de sensibilisation et de préparer le système de santé à répondre au paludisme induit par le climat. Cela impliquait que des programmes tels que la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier pourraient être améliorés en les prolongeant jusqu'à la période intermédiaire.
Remarques:
Malheureusement, Toussaint n'a pas pu présenter son exposé en raison de problèmes techniques.
Juge Aheto
Pays : Ghana
Établissement : Université du Ghana
Thème : Cartographie du risque de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en tenant compte des facteurs environnementaux et climatiques afin de contribuer aux efforts de prévention et de lutte contre le paludisme au Ghana : méthodes de cartographie géospatiale bayésienne et interactives sur le Web.
Résumé
Le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne. Au Ghana, le paludisme est responsable d'environ 20 000 décès chez les enfants chaque année, dont 25 % chez les moins de 5 ans. Pour permettre une surveillance efficace du paludisme et des efforts de lutte ciblés dans un contexte de ressources de santé publique limitées, des cartes spatiales interactives à haute résolution sur le Web caractérisant les différences géographiques en matière de risque de paludisme sont nécessaires. Méthodes : Cette étude de modélisation a utilisé les données de l'enquête sur les indicateurs du paludisme de 2019. Une nouvelle modélisation géospatiale bayésienne et des approches cartographiques interactives sur le Web ont été utilisées pour examiner les prédicteurs et les différences géographiques du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. Des cartes de visualisation interactives en ligne du risque de paludisme prévu ont été développées. En 2019, 718 (25 %) des 2 867 enfants de moins de cinq ans interrogés étaient atteints du paludisme. Des différences géographiques importantes ont été observées en ce qui concerne le risque de paludisme chez les moins de 5 ans. La couverture des MII (cote logarithmique 4,5643, intervalle de crédibilité à 95 % = 2,4086 — 6,8874), le temps de trajet (cote logarithmique 0,0057, intervalle de crédibilité à 95 % = 0,0017 — 0,0099) et l'aridité (cote logarithmique = 0,0600, intervalle crédible = 0,0079 — 0,1167) étaient des indicateurs prédictifs du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le modèle spatial. La prévalence nationale globale du paludisme était de 16,3 % (erreur type (SE) 8,9 %) avec une fourchette de 0,7 % à 51,4 % dans le modèle spatial avec covariables et une prévalence de 28,0 % (ET 13,9 %) avec une fourchette de 2,4 à 67,2 % dans le modèle spatial sans covariables. Le fait de résider dans certaines régions des régions du Centre et de Bono East était associé au risque le plus élevé de contracter le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans après ajustement pour tenir compte des covariables sélectionnées. Les cartes prédictives interactives en haute résolution sur le Web peuvent être utilisées comme un outil efficace pour identifier les communautés nécessitant des interventions urgentes et ciblées de la part des gestionnaires et des responsables de la mise en œuvre des programmes. Cela est essentiel dans le cadre d'une stratégie globale visant à réduire le fardeau du paludisme chez les moins de 5 ans et la morbidité et la mortalité associées dans un pays aux ressources de santé publique limitées où une intervention universelle est pratiquement impossible.
Remarques:
La justice a commencé par l'introduction du fardeau du paludisme en général. Il a utilisé l'enquête sur les indicateurs du paludisme au Ghana et s'est concentré sur les résultats de la positivité du TDR. Il a utilisé un modèle binomial comportant un certain nombre de covariables et une composante spatiale. Il a utilisé des méthodes spatiales pour prédire la prévalence du paludisme à l'échelle du pays et a présenté un outil interactif en ligne pour le NMCP.
Alvan Coker
Pays : Libéria
Établissement : Institut national de santé publique du Libéria et École de santé publique de l'Université du Libéria
Thème : Modélisation de l'impact d'un comportement sexospécifique sur le risque accru de transmission de la fièvre de Lassa chez les femmes du comté de Grand Bassa, au Libéria
Résumé
Au Libéria, les épidémies de fièvre de Lassa avec un taux de létalité élevé se sont généralisées malgré la mise en œuvre d'un plan national visant à juguler la maladie. Le comté de Grand Bassa connaît une transmission soutenue depuis 2021. Afin de démontrer l'impact potentiel d'une intervention sur les voies de transmission comportementales, nous avons développé un modèle mathématique pour la fièvre de Lassa axé sur le district 3A&B du comté de Grand Bassa. Un modèle compartimental de transmission de la fièvre de Lassa a été paramétré à l'aide de données de surveillance de routine et de listes détaillées de lignées épidémiques. Le modèle a été stratifié par sexe afin de saisir les pratiques socio-comportementales supposées par les parties prenantes nationales pour augmenter le risque de transmission chez les femmes par rapport aux hommes. Un sous-modèle de rongeur a été ajusté pour tenir compte de l'infection différentielle entre les rats Mastomys à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et de la saisonnalité de l'abondance des vecteurs. Le modèle complet a ensuite été ajusté aux données relatives au nombre de cas par sexe et au nombre global de décès. L'impact des interventions comportementales sur le nombre de cas différentiel entre les hommes et les femmes a été quantifié. Des données sociodémographiques, cliniques, épidémiologiques et comportementales sur 83 cas confirmés de fièvre de Lassa (63 % de femmes) signalés dans les listes linéaires entre 2017 et 2022 étaient disponibles pour le district 3A&B. Le modèle prévoyait une incidence cumulée de 50,9 cas de femmes demandeuses de soins (IQR : 35,4-76,4) et de 22,7 cas de femmes demandeuses de soins (15,4-33,2) pour 2023-2027. Le nettoyage de l'environnement visant à réduire le recrutement de rongeurs dans les maisons a entraîné les plus fortes réductions globales du nombre de cas, tandis que des pratiques de manipulation plus sûres de la viande de rongeurs chassée ont considérablement réduit les disparités dans le nombre de cas. La réduction de la transmission par la consommation d'aliments découverts et contaminés a accru les disparités dans le nombre de cas. Diverses données locales ont été utilisées pour élaborer le premier modèle de fièvre de Lassa au Libéria. En tenant compte des aspects de la transmission qui apparaissent régulièrement lors des discussions entre les parties prenantes nationales, le modèle est conçu pour maximiser son utilisation, en particulier par le groupe de travail technique sur la fièvre de Lassa récemment créé au Libéria.
Remarques:
Malheureusement, Alvan n'a pas pu présenter son exposé en raison de problèmes techniques.
Séquoia Leuba
Pays : Royaume-Uni
Établissement : Imperial College de Londres
Thème : Quantifier l'impact du paludisme pendant la grossesse sur l'anémie maternelle et le fardeau qui y est associé en Afrique.
Résumé
L'infection au plasmodium pendant la grossesse provoque une anémie maternelle, mais les estimations quantitatives de la charge du paludisme sur l'anémie maternelle font défaut, en partie parce que l'impact des infections non traitées ne peut pas être mesuré de manière éthique. Pour combler cette lacune, nous avons utilisé des données individuelles sur les concentrations d'hémoglobine (Hb) et le statut PCR du paludisme lors de l'inscription à 4 essais récents portant sur des approches alternatives de prévention du paludisme pendant la grossesse, impliquant 12 608 femmes dans sept pays (Burkina Faso, Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, Mali et Tanzanie). Nous avons développé un cadre inférentiel bayésien pour prendre en compte les différents critères d'exclusion des essais, en utilisant les données relatives à l'âge gestationnel au moment de l'inscription comme mesure indirecte de la durée pendant laquelle une infection n'a pas été traitée afin de capturer la dynamique de l'Hb jusqu'à la fin du deuxième trimestre (T2). Nous estimons que chez les femmes primigravides, les baisses de l'Hb associées à l'infection palustre augmentent tout au long de la gestation, atteignant une réduction de 1,24 [intervalle de crédibilité (IC) à 95 % 1,13, 1,36] g/dL à la fin du T2. En tenant compte des baisses concomitantes de l'Hb tout au long de la gestation chez les femmes non infectées, nous estimons que, chez les primigravidés présentant une infection continue, le risque d'anémie sévère associée au paludisme (Hb < 7 g/dL) augmente de 2,2 % [IC à 95 % 1,1-3,5] à 14,3 % [IC à 95 % 10,8-17,9] entre la fin du premier trimestre (T1) et le T2. L'impact du paludisme sur l'Hb chez les femmes multigravides variait selon l'intensité de la transmission, l'impact étant similaire à celui des primigravidés dans les zones de faible prévalence, mais diminuant de plus en plus dans les zones de transmission plus élevée, suivant des modèles bien connus d'acquisition d'une immunité antipaludique spécifique à la grossesse. À l'aide de la modélisation, nous estimons que chez les femmes qui ont été infectées au cours d'une grossesse précédente, la réduction de la concentration d'Hb associée à une infection persistante à la fin de la T2 est de 0,38 [IC à 95 % 0,21, 0,55] g/dL, et aucune réduction de la concentration d'Hb lors des grossesses ultérieures. À l'aide de ce cadre, nous extrapolerons la charge associée à travers l'Afrique à l'aide d'estimations de la fécondité et de l'endémicité du paludisme recueillies par le projet Atlas du paludisme et l'Organisation mondiale de la santé.
Remarques:
Sequoia a évoqué le nombre de grossesses touchées par le paludisme (13,3 millions) et ses conséquences en termes d'anémie. Elle a utilisé un modèle existant de paludisme pendant la grossesse et a modélisé l'évolution du taux d'hémoglobine en fonction de l'âge gestationnel. Elle a montré comment l'immunité varie en fonction de la gravidité de l'individu. Ils l'ont donc étendue pour voir comment le nombre de grossesses influe sur l'impact du paludisme sur l'anémie. Dans l'ensemble, l'impact du paludisme sur l'anémie s'aggrave pendant la gestation et l'impact est le plus marqué chez les femmes qui en sont à leur première grossesse. Elle a montré comment cet impact différait selon les paramètres de transmission élevés et faibles. Dans le premier cas, l'impact varie en fonction de la gravidité (c'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont infectées par le paludisme lors de grossesses précoces) tandis que, dans le second cas, le paludisme a un impact continu avec un nombre croissant de grossesses.
Au cours de la session questions-réponses, Sequoia a déclaré qu'elle intégrerait ensuite l'iPTP dans le modèle. Elle a également parlé de nombreuses infections palustres transmises avant la grossesse et de l'importance de soins prénatals précoces.
Session 3 : Modélisation des antipaludéens
Animé par Antonio Nkondjio Christophe, OCEAC, Yaoundé, Cameroun
Gina Cuomo-Dannenbourg
Pays : Royaume-Uni
Établissement : Imperial College de Londres
Thème : Aptitude potentielle de la sulfadoxine-pyriméthamine et de l'amodiaquine à la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les zones présentant une résistance médicamenteuse préexistante élevée.
Résumé
La chimioprévention du paludisme saisonnier (SMC) cible le fardeau du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans dans les zones de transmission du paludisme saisonnier. Auparavant, l'OMS ne recommandait le SMC que dans la région du Sahel, qui présente de faibles niveaux de résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine (SP), l'un des médicaments utilisés pour l'intervention. Cependant, en 2022, les restrictions géographiques ont été supprimées des directives de l'OMS, ce qui a incité de nouveaux pays à envisager la SMC comme une intervention possible. Il est nécessaire de déterminer si le SP-AQ serait toujours efficace dans les zones présentant une résistance élevée au SP afin d'orienter l'expansion du SMC vers de nouvelles zones géographiques. Ici, nous utilisons les données des premiers essais contrôlés randomisés sur le SMC en dehors de la région du Sahel pour estimer la protection fournie par le SMC, qui a démontré une efficacité protectrice de 77 % au 28e jour, même dans les zones où une résistance élevée à la SP est établie. Nous utilisons des méthodes d'inférence bayésienne pour estimer la probabilité que le SMC utilisant le SP-AQ prévienne une infection en fonction du temps écoulé depuis l'administration du médicament, de la saisonnalité, de la transmission initiale et de la fréquence existante des mutations conférant une résistance à la SP. Nous utilisons actuellement ces résultats dans le cadre d'un modèle de transmission individuel de Plasmodium falciparum existant et largement validé pour estimer l'impact potentiel de la mise en œuvre du SMC selon divers scénarios, notamment en explorant le nombre de cycles, leur calendrier et la tranche d'âge appropriée. Les premiers résultats suggèrent que dans une zone comptant 64,7 % de cas cliniques en 4 mois et présentant une mutation quintuple du facteur dhfr-dhps établie, la SMC utilisant quatre cycles de SP-AQ pourrait prévenir 51,1 % (IC à 95 % : 37,0 à 65,2 %) des cas cliniques annuels de Plasmodium falciparum chez les enfants de moins de cinq ans. Malgré la forte résistance aux médicaments déjà présente en Afrique de l'Est et en Afrique australe, nous prévoyons que le SMC a le potentiel d'être une intervention antipaludique très efficace et pourrait contribuer à éviter une partie de l'importante charge de morbidité du paludisme chez les jeunes enfants dans ces zones géographiques. Il sera important de prendre en compte l'impact de l'augmentation de la SMC sur la résistance au SP et à l'AQ dans les zones où la résistance au SP est déjà relativement élevée.
Remarques:
Gina a expliqué le rôle du SMC dans la prévention du paludisme chez les enfants les plus exposés. SP + AQ est le schéma thérapeutique le plus courant pour le SMC, mais la SP était le principal traitement de première intention en Afrique orientale et australe, de sorte qu'il existe une résistance dans ces régions. Un modèle de transmission, Simulation, a été utilisé pour examiner l'impact de la résistance sur l'impact du SMC. Le modèle a montré que la résistance à la SP a un impact sur l'efficacité du SMC, mais qu'elle est toujours susceptible d'être très efficace en Afrique de l'Est et en Afrique australe.
La première question portait sur les différences entre le pourcentage de réduction utilisé à l'aide de cadres bayésiens par rapport à l'analyse de survie classique et Gina a expliqué que la première inclut une intensité de transmission et une intensité médicamenteuse variables comme effet décroissant. La deuxième question portait sur l'impact programmatique probable, car celui-ci est souvent inférieur à l'impact des essais. Gina a expliqué que les résultats présentés ici sont prudents et se rapprochent probablement davantage des résultats programmatiques que des résultats d'essais.
Constance Ciavarella
Pays : France
Établissement : Institut Pasteur
Thème : Tracer la voie à suivre pour résoudre le dilemme du traitement par P. vivax : une étude de modélisation intégrant les données des essais cliniques et la dynamique de transmission.
Résumé
Lors de la primo-infection, certains parasites du Plasmodium vivax (Pv) se transforment en hypnozoïtes qui restent dormants dans le foie pendant des semaines, voire des mois, avant de se réactiver pour provoquer des rechutes. Le traitement de la Pv nécessite donc une cure radicale, un type de thérapie qui élimine les parasites du flux sanguin et du foie. Plusieurs essais contrôlés randomisés (ECR) ont comparé des schémas thérapeutiques à ceux de la primaquine (PQ) et de la tafénoquine (TQ) pour le stade hépatique. Bien qu'il soit possible d'estimer l'efficacité individuelle de ces régimes médicamenteux, leur impact au niveau de la population doit encore être évalué dans le cadre d'essais randomisés en grappes. De tels essais sont nécessaires pour mesurer les effets non linéaires sur la transmission dus à une circulation plus faible et hétérogène du Pv et à une diminution de l'immunité de la population. Nous avons développé un modèle de risque d'infection et l'avons adapté aux données de l'essai IMPROV (deux schémas de QP et un groupe témoin testés sur plusieurs sites) en supposant que les taux de rechute et de morsure dépendent de la localisation, mais que l'efficacité du médicament reste constante d'un site à l'autre. Ensuite, nous avons estimé l'impact au niveau de la population de l'introduction d'un traitement radical dans la prise en charge des cas à l'aide d'un modèle de transmission du PV existant couvrant plusieurs scénarios qui varient en fonction de l'intensité de la transmission, de la saisonnalité, des taux de rechute du PV et du comportement de recherche de soins. En combinant nos estimations d'efficacité avec les ratios de risque et les données d'observance issues des RCT, nous avons testé plusieurs schémas thérapeutiques radicaux en variant la posologie et la durée d'administration. Les efficacités estimées pour les régimes IMPROV PQ de 7 et 14 jours (dose totale de 7 mg/kg) étaient de 81 % (IC à 95 % : 66 % à 96 %) et 86 % (IC à 95 % : 72 % à 99 %), respectivement. L'introduction d'un traitement radical peut rendre l'élimination possible là où la transmission est déjà faible (< 2 % de prévalence de la PCR). À mesure que l'intensité de la transmission augmente, l'efficacité de la guérison radicale est considérablement réduite et les différences entre les schémas thérapeutiques s'atténuent. À ce jour, PQ et TQ ont été testés dans des conditions d'essai, tandis que les implémentations réelles introduisent de nombreuses contraintes qui entravent leur impact au niveau de la population. Plutôt que de se concentrer sur une dose et une durée d'administration optimales, il pourrait donc être plus efficace d'augmenter les taux d'observance et de recherche de soins, et d'élargir les critères d'éligibilité.
Remarques:
Constanze a expliqué les différences entre Plasmodium falciparum et vivax. Dans ce dernier cas, les hypnozoïtes restent dormants dans le foie pendant des semaines, voire des mois, et peuvent se réactiver, entraînant une rechute. Deux médicaments, la primaquine et la tafénoquine, ciblent les parasites au stade hépatique, mais la mise en œuvre de ce traitement est délicate en raison de graves effets secondaires chez certaines personnes. L'association de médicaments au stade sanguin et hépatique est appelée guérison radicale.
Constanze a développé un modèle comprenant un compartiment sensible contenant des hypnozoïtes, qui peuvent être réinfectés ou rechuter, un compartiment infecté présentant une infection au stade sanguin et un compartiment sensible sans hypnozoïtes qui ne peut que se réinfecter. Elle a présenté l'effet potentiel de la guérison radicale sur les populations à transmission faible, moyenne et élevée en utilisant un modèle de transmission individuel.
Séance d'affiches
Des affiches seront publiées prochainement.
Table ronde : Expériences relatives à la création et à la gestion de chapitres régionaux de l'AMMNet

Modérateur : Antonio Nkonjio Christophe
Panélistes :
- Monsieur Kapnang Ivan, AMMNet Cameroun, épidémiologiste au Centre des maladies infectieuses, travaille sur des projets de modélisation pour la Fondation Bill & Melinda Gates.
- Maison de thé Getachew, AMMNet Corne de l'Afrique
- Isaïe Agorinya, AMMNet Ghana enseigne l'épidémiologie et la biostatistique à l'université des sciences de la vie et participe actuellement à un programme d'enrichissement du corps professoral à la Northwestern University.
- Abdourahamane Diallo, AMMNet Francophone, étudie la santé publique et travaille pour le programme national de lutte contre le paludisme en Guinée.
- Carmène Sandra Ngadjeu, AMMNet francophone
Remarque : les questions et les réponses ont été paraphrasées.
Question 1 : Veuillez décrire les activités que vous avez entreprises dans le cadre de vos sections AMMNet.
Isaiah Agorinya : le processus de démarrage d'AMMnet Ghana a débuté en octobre dernier. IA a contacté des collègues, a créé un groupe WhatsApp et a inclus toutes les personnes intéressées. La première réunion virtuelle a eu lieu en décembre 2022, la deuxième le 31 mars 2023 et la troisième la semaine dernière, au cours de laquelle un collègue a présenté ses travaux. IA a créé une chaîne Slack locale aux côtés de WhatsApp pour diffuser des informations. Le secrétariat de l'AMMNet a accordé une nouvelle subvention pour un atelier qui est prévu pour la deuxième semaine de décembre.
Nom de Kapnang Ivan : a contacté Shannon et a participé très activement aux webinaires de l'AMMNet. Il a été choisi pour représenter le Cameroun. Il existe une partie anglophone et une partie francophone dans AMMnet Cameroun. Deux subventions ont été accordées ; la première pour organiser une conférence sur la modélisation et la seconde pour la formation d'entomologistes. Le prochain projet est d'organiser un symposium.
Getachew Teshome : L'AMMNet de la Corne de l'Afrique n'en est qu'à ses balbutiements. Ils ont organisé un atelier l'année dernière, qui s'est avéré utile pour le travail collaboratif (plutôt que dans des silos). Les membres de l'AMMNet Corne de l'Afrique souffrent eux-mêmes du paludisme, c'est donc particulièrement important pour eux. Ils espèrent combler de nombreuses lacunes techniques.
Question 2 : Quels sont les défis de l'espace francophone AMMNet ? La langue constitue-t-elle un obstacle et comment l'AMMNet anglophone pourrait-il contribuer à renforcer le groupe francophone ?
Abdourahamane Diallo : L'AMMNet francophone a également créé des groupes WhatsApp et a atteint 7 pays. Ils essaient de tenir des réunions mensuelles et invitent des chercheurs français à des webinaires. La formation est délicate car les modélistes francophones sont peu nombreux. Le plan est de développer la formation pour renforcer les capacités. AMMNet encourage la modélisation en Afrique et cela devrait inclure l'Afrique francophone.
Carmène Sandra Ngadjeu : La langue est définitivement un obstacle et plus de personnes seraient intéressées par le mannequinat s'ils parlaient anglais. L'AMMnet Francophone souhaiterait que des activités soient menées en français et aimerait être incluse dans la communauté AMMnet au sens large et être soutenue.
Question 3 : Qu'en est-il du rôle des femmes dans le mannequinat ? Comment pouvons-nous encourager les femmes ?
Carmène Sandra Ngadjeu : Malheureusement, les femmes s'intéressent moins au mannequinat que les hommes. Seulement 1 modéliste sur 10 est une femme, mais les femmes peuvent être modélisatrices et devraient bénéficier d'un soutien.
Abdourahamane Diallo : Des bourses visant à renforcer l'engagement des femmes pourraient être utiles. Il a reconnu que peu de femmes en Afrique s'intéressent au mannequinat. Des bourses pour des programmes de formation seraient utiles.
Question 4 : Comment AMMNet peut-il aider à soutenir les chapitres ?
Isaiah Agorinya : AMMnet propose des séminaires mensuels, une assistance de secrétariat et un accès gratuit à Zoom. La formation est essentielle, notamment en raison de la diversité des parcours au sein des équipes.
Question 5 : Comment garantir la durabilité ?
Nom de Kapnang Ivan : la durabilité est liée à l'innovation, il est important de tirer des leçons des autres chapitres et d'avoir des échanges pour renforcer les capacités et la collaboration.
Antonio Nkonjio Christophe : A suggéré la création d'une base de données des modélisateurs de chaque pays à utiliser comme ressources potentielles.
Question 5 : Quels sont les défis du chapitre de la Corne de l'Afrique en termes d'inclusion de plusieurs pays ?
Getachew Teshome : Le capital d'amorçage d'AMMNet a permis de réunir les modélisateurs et les décideurs politiques.
Isaiah Agorinya : comment la branche de la Corne de l'Afrique gère-t-elle le besoin de formation en présentiel lorsque les personnes se trouvent dans différents pays ? Est-ce durable ?
Getachew Teshome : il est entendu que l'AMMNet ne soutiendra pas toujours toutes les activités. Ils ont discuté de la mise à l'échelle, plutôt comme s'il s'agissait d'une association facturant des frais d'adhésion.
Question 6 : Comment le Nord mondial peut-il aider le Sud étant donné qu'il y a moins de modélisation dans le sud ? Quelles sont les relations entre le Nord et le Sud, comment l'Afrique peut-elle bénéficier de cet intéressant réseau ?
Abdourahamane Diallo : Il est important de transférer des compétences et de renforcer les capacités en Afrique. D'autres projets sur la modélisation du paludisme devraient être organisés en Afrique.
Carmène Sandra Ngadjeu : Tout d'abord, il est nécessaire de créer un réseau actif de modélisateurs comprenant des modélisateurs anglophones et francophones en collaboration. Les programmes de formation sont importants. Les modélistes nordiques sont loin. Il est également important de se concentrer sur les pays et de s'assurer qu'il existe un réseau.
Question 7 : Des messages à retenir ?
Getachew Teshome : L'AMMNet est une bonne occasion de rassembler les gens.
Abdourahamane Diallo : L'objectif ultime est d'éliminer le paludisme et des investissements devraient être investis dans le développement des compétences locales. Les capacités humaines nécessaires à la prise de décisions existeront alors. L'aide ne viendra pas toujours de l'extérieur et l'engagement doit être soutenu et localisé.
Discussions en petits groupes
Voir ici pour les diapositives présentées à l'issue des discussions en petits groupes.
Allocution de clôture
Jaline Gerardin a clôturé la réunion en remerciant tous ceux qui ont contribué à son organisation et a attendu avec impatience la prochaine réunion de l'AMMNet à Kigali en 2024.